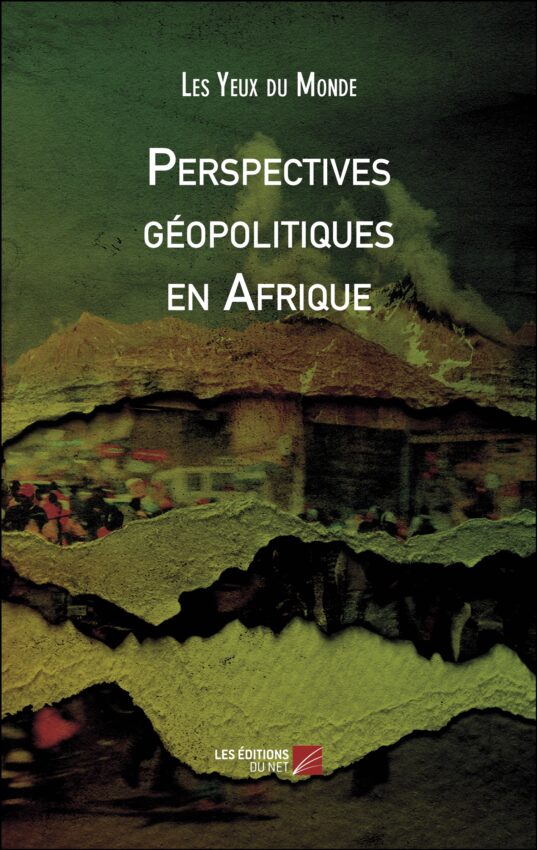Groenland : Trump, Danemark et souveraineté en tension
Alors que la Première ministre du Danemark Mette Frederiksen s’est rendue à Nuuk ce 3 avril 2025 pour réaffirmer l’unité du royaume avec le Groenland, le territoire arctique se retrouve à nouveau au centre d’un bras de fer géopolitique. Donald Trump, revenu au pouvoir, multiplie les déclarations provocatrices en faveur de l’annexion de l’île pour des raisons de sécurité nationale, réveillant les tensions entre Washington, Copenhague et Nuuk. Mais au-delà de l’agitation diplomatique, ce regain d’intérêt pour le Groenland révèle des enjeux bien plus vastes : aspirations indépendantistes, quête de souveraineté, héritage colonial non résolu, compétition stratégique et vulnérabilité sociale.

Le Groenland : une position géostratégique au cœur des rivalités internationales
Territoire autonome danois depuis 1979 et vaste comme quatre fois la France, le Groenland s’impose aujourd’hui comme un acteur central dans les dynamiques géopolitiques de l’Arctique.
Sa localisation entre l’Amérique du Nord, l’Europe et la Russie lui offre une importance stratégique majeure, en particulier pour les États-Unis. La base militaire de Pituffik (ex-Thulé) y constitue un avant-poste crucial, accueillant un radar du Ballistic Missile Early Warning System et des infrastructures de la Space Force, essentielles à la surveillance spatiale et balistique. Inquiets de l’expansion des ambitions chinoises et russes dans l’Arctique, notamment autour de la « route de la soie polaire » et du gisement de terres rares de Tanbreez, les États-Unis renforcent leur présence sur l’île. Toutefois, des experts danois, comme Peter Viggo Jakobsen, appellent à la prudence : « Il n’y a pas de navires russes ou chinois» traversant les eaux avoisinant le Groenland.
Une terre riche en ressources, au centre des convoitises
Au-delà de son importance militaire, le Groenland attire les convoitises pour ses ressources minières encore largement inexploitées. Une étude danoise récente révèle que 23 des 34 matières premières critiques identifiées par l’Union européenne, dont les terres rares, le lithium, le graphite ou encore le zinc, sont présentes sur l’île, ce qui pourrait faire du Groenland un acteur clé dans la transition énergétique mondiale.
Cependant, le développement minier au Groenland fait face à de nombreux obstacles, dont les conditions climatiques extrêmes, le manque d’infrastructures, les lenteurs administratives et les incertitudes réglementaires. À cela s’ajoutent des décisions politiques, comme l’interdiction de l’exploitation de l’uranium en 2021 par le parti socialiste, Inuit Ataqatigiit, qui a stoppé le projet Kvanefjeld.
Dans ce contexte, l’intérêt renouvelé des États-Unis prend une tournure plus offensive. Depuis 2019, Donald Trump affiche son ambition d’acheter ou d’annexer l’île. En effet, il avait déjà déclaré qu’il serait stratégiquement intéressant d’acheter le Groenland, et qu’il s’agirait d’une « grosse transaction immobilière ». En 2025, cette volonté se concrétise à travers des visites officielles, des évaluations budgétaires et des déclarations fortes : « Nous avons besoin du Groenland pour la sécurité internationale. Il nous le faut », a-t-il affirmé le 26 mars (Journal de Montréal, 26 mars 2025). Son vice-président JD Vance s’est rendu à Pituffik pour dénoncer le désengagement du Danemark, tandis que la Maison-Blanche envisage une offre économique plus attrayante que l’actuelle subvention danoise, estimée à 600 millions USD par an. Face à ces pressions, le Groenland apparaît aujourd’hui comme un territoire convoité à la croisée des enjeux énergétiques, militaires et géopolitiques.
Un réveil nationaliste face aux pressions de Trump
L’offensive diplomatique des États-Unis sur le Groenland a produit un effet inattendu : elle a ravivé les aspirations indépendantistes. Le nouveau Premier ministre groenlandais, Jens-Frederik Nielsen, a répondu fermement à Donald Trump : « Les États-Unis n’obtiendront pas le Groenland. Nous n’appartenons à personne d’autre. Nous décidons de notre propre avenir ». Ce regain de souverainisme s’est traduit politiquement lors des élections législatives du 11 mars 2025, remportées par une coalition rassemblant plusieurs partis indépendantistes ou autonomistes. Bien qu’aucun référendum d’indépendance ne soit encore à l’agenda, la loi d’autonomie de 2009 autorise légalement le Groenland à en organiser un. D’après un sondage mené en janvier 2025, une majorité de Groenlandais s’oppose à toute forme de rattachement aux États-Unis, préférant poursuivre leur propre voie vers une émancipation progressive.
Le poids d’un passé colonial toujours présent
Les revendications indépendantistes groenlandaises s’enracinent aussi dans une histoire coloniale douloureuse avec le Danemark. Ces dernières années, plusieurs révélations ont profondément marqué l’opinion publique : stérilisations forcées de jeunes femmes inuites dans les années 1960-1970, séparations familiales avec des enfants envoyés au Danemark pour y être assimilés, ou encore persistance des inégalités linguistiques et du racisme dans les institutions danoises. Ce passé longtemps ignoré est désormais au cœur du débat public. L’émotion suscitée par ces scandales, renforcée par les travaux de la commission de réconciliation, a conduit à une remise en question du lien entre Copenhague et Nuuk. Pour la chercheuse Astrid Nonbo Andersen, cette prise de conscience marque un tournant : « Pour la première fois, les Danois se demandent ce que leur apporte le Groenland et pourquoi forcer les Groenlandais à rester s’ils veulent partir ».
Une souveraineté en quête de justice sociale et de mémoire réparée
Derrière l’agitation géopolitique, la réalité sociale du Groenland reste préoccupante. Malgré les rêves de prospérité liés à l’exploitation minière ou au développement touristique, la société groenlandaise est profondément marquée par des fragilités sociales persistantes. Le territoire affiche l’un des taux de suicide les plus élevés au monde (81 pour 100 000 habitants), une précarité généralisée, une pénurie chronique de logements et une démographie en déclin inquiétant. Selon Steven Arnfjord, chercheur en sciences sociales à l’université du Groenland, « on ne peut pas parler d’indépendance sans parler de modèle social ». La jeunesse groenlandaise, tout en réclamant une souveraineté politique, exige aussi des réponses concrètes à ces défis structurels.
Ces revendications s’inscrivent dans une dynamique de réappropriation historique. Le pays reste marqué par les stigmates du colonialisme danois : stérilisations forcées d’Inuites dans les années 1960-70, séparations d’enfants envoyés au Danemark pour être « assimilés », discriminations linguistiques et racisme institutionnel. La commission de réconciliation a permis de remettre ces traumatismes au cœur du débat public, au Danemark comme au Groenland.
Dialogue fragile et absence européenne au Groenland
Face aux tensions croissantes entre le Groenland et le Danemark, la Première ministre danoise Mette Frederiksen a multiplié les gestes d’apaisement. En visite à Nuuk les 3 et 4 avril, elle a réaffirmé l’unité du royaume et exprimé son opposition à toute tentative de rachat ou d’annexion du Groenland. Son gouvernement a promis un dialogue renforcé, annoncé un plan de lutte contre le racisme anti-groenlandais, ainsi que des investissements militaires dans l’Arctique pour un montant de 14,6 milliards de couronnes. Pourtant, nombre de Groenlandais restent sceptiques quant à la sincérité de Copenhague. « Ce que veulent les Groenlandais, c’est être vus et reconnus », résume Mikaela Engell, ancienne représentante danoise au Groenland.
Pendant ce temps, l’Union européenne reste étonnamment en retrait. Bien que des accords ont été signés avec Nuuk sur les matières premières critiques, les actions concrètes restent jugées timides. Ce manque d’engagement alimente la frustration des autorités locales, qui appellent à une implication plus marquée de leurs partenaires européens.
Ainsi, le Groenland est bien plus qu’un territoire stratégique ou une réserve de ressources minières. C’est aussi une société en pleine mutation, en quête de reconnaissance, de justice sociale et de souveraineté. L’insistance de Donald Trump à vouloir acheter l’île a, paradoxalement, provoqué un réveil historique. Elle a poussé tant les Groenlandais que les Danois à repenser les relations au sein du royaume. Reste à savoir si cette dynamique débouchera sur une indépendance effective, ou sur une nouvelle forme de dépendance, cette fois envers Washington.